- Accueil
- Léon Aréga
Léon Aréga
Du Débarras aux oubliettes
Pourquoi les hommes tombent-ils en court de route ?
Pourquoi n’arrivent-ils pas ?
Pourquoi partent-ils ?
Pourquoi, partis et tombés en cours de route
S’épuisent-ils à découvrir
Le brin d’herbe qui les a fait glisser ?
Pourquoi cherchent-ils sans raison et sans espoir
A nommer le galet qui les a fait trébucher
Alors que tous les galets se valent ?
Léon Aréga

De nombreux écrivains, après un moment de gloire sombrent dans l’oubli puis reviennent à nouveau réveiller notre mémoire. Cette renaissance est souvent due au hasard des lectures d’autres écrivains ou de passionnés de littérature qui les découvrent et nous font part de leur enthousiasme.
La liste de ces retrouvailles est, nous le savons, longue ; mais elle l’est également pour ceux dont rien ne laisse présager leur retour dans nos librairies et dans nos bibliothèques sous la forme de fraîches rééditions.
Ainsi : Qui se souvient de Léon Aréga ?
Ce nom pour ma part s’est glissé furtivement par deux fois dans mes lectures.
La première dans un recueil de textes de Roger Grenier sur son expérience du monde radiophonique : Fidèle au poste (Gallimard, 2001). Le chapitre consacré à Léon Aréga s’intitule : Le Paradis, c’est les autres ! Un texte émouvant dans lequel Roger Grenier nous révèle entre autre : Son œuvre dont chaque titre a quelque chose de négatif et semble déjà revendiquer l’obscurité, ‘Comme si c’était fini’, ‘À l’essai’, ‘Pseudonymes’, ‘Aucune trace’, ‘Le Débarras’, n’a rencontré que peu de lecteurs et a bientôt disparu.
La seconde dans un numéro du Matricule des Anges de Juillet-août 2005 consacré à Henri Calet. Léon Aréga y est évoqué par Eric Holder dans une chronique intitulée Les enfants des Calet. En parlant de Dominique Gaultier du Dilettante, il s’interroge : Qui d’autre, s’éclairant au nom de Léon Aréga, entre Hennebont et Auray (Eric et Dominique démarchaient pour le Dilettante sur les routes de France), serait capable de citer des titres, Le débarras, ou Comme si c’était fini ? Sans doute les anciens de la bande, auxquels viennent s’ajouter d’autres que je ne connais pas.
Deux furtives évocations qui m’avaient incité, à l’époque, à noter sur l’un de mes carnets : Léon Aréga – Le Débarras comme il m’arrive de le faire pour des auteurs que je ne connais pas en prévoyant de les découvrir.
Mais avant de repenser à cette note, le hasard m’offrit l’opportunité de tomber sur un exemplaire de l’œuvre d’Aréga.
Souvent le long de la rue Saint-Charles s’installent des journées de brocante. Ce jour de brocante-là, je n’étais en quête de rien et marchais même d’un pas peu badaud parmi les étalages de vaisselles, de toiles peintes, de vêtements et bien sûr de livres. Lorsqu’au-dessus d’un tas de bouquins étalés sans soin sur une table un exemplaire du Débarras de Léon Aréga me lança, par je ne sais quel insistant bonheur, un clin d’œil provocateur.
Le vendeur osa à peine me réclamer la somme d’un euro pour cet ouvrage. J’allais devenir pour cet euro-là l’un des peu de lecteur de ce roman.
*
Avant de me lancer dans sa lecture, j’eus un réflexe que la plupart d’entre nous adopte de nos jours lorsqu’un nom, un lieu, une chose leur est inconnu ou sur laquelle ils ne possèdent que peu d’informations : on googlelise !...
Je tapai donc sur le moteur de recherche tant vénéré : Léon Aréga. Dans les cinq milles réponses dénichées, à ma grande déception pas de pages Wikipédia, aucune trace de biographie, aucune photo, aucune miette d’existence, aucun indice de passé… Notre écrivain était bel et bien enterré (où donc d’ailleurs ?). Les seuls pages qui mentionnent son nom sont en grande partie ou bien des sites de collecte de citations ou bien des sites de revendeurs de livres anciens.
Pour les premiers, il semble que l’on se soit passé, de bouche à oreille, deux phrases que chacun répète en une sorte de funèbre écho :
Chacun rate sa vie, à sa manière, selon ses moyens et ses convictions ;
puis : Un journal fait par des gens qui ne savent pas écrire pour des gens qui ne savent pas lire.
Ces deux citations figurent dans les pages du Débarras.
Pour les seconds, ils proposent les rares ouvrages de Léon Aréga encore disponibles. Ceux répertoriés en dernière page de celui que j’avais acquis.
En vingt ans, de 1947 à 1967, Léon Aréga publia un récit et cinq romans : Comme si c’était fini (le récit) 1947, À l’essai - 1951, Le même fleuve - 1954, Pseudonymes - 1957, Aucune trace - 1963 et Le Débarras - 1967. L’ensemble aux éditions Gallimard.
Il est rare de mettre la toile (comme on dit) en échec, avec un nom aussi fantomatique que celui de Léon Aréga je l’avais mise mat.
Ce grand trou noir m’émut et m’incita à rédiger une sorte de Tombeau, d’hommage posthume, d’atteindre l’auteur par ces quelques lignes, comme par une main tendue vers lui et son passé.
Pour découvrir l’homme avant l’œuvre –tout en sachant bien que j’enfreignais là le conseil de Jorge Luis Borges d’ignorer la vie de l’auteur et l’époque où il vécut pour aborder l’œuvre sans le brouillage d’images d’Epinal et d’anecdotes intimes, mais bon… – je ne possédais qu’un unique recours : Roger Grenier.
À la lecture du chapitre de Fidèle au poste, il avait visiblement connu de près notre homme.
Je le contactai.
Il me conseilla dans un premier temps de lire les deux romans qui bornent la production d’Aréga : Comme si c’était fini et Le Débarras. Puis m’avoua que dans l’une de ses fictions : La Follia (Gallimard 1980) le caractère et le physique du personnage baptisé Bunim dans ce roman étaient empruntés pratiquement sans retouches romanesques à ceux de Léon Aréga.
Dans notre conversation, Roger Grenier ajouta également quelques anecdotes.
Je pouvais à présent, en partant de ces éléments, tenter de frotter le portrait vieilli et oxydé de cet auteur pour essayer de faire apparaitre une image débarrassée des brumes qui l’enveloppaient sans pour autant, je le pressentais, atténuer complétement certains flous.
*
Léon Aréga, nous le savons, est un pseudonyme. Mais quel nom authentique se cache derrière ce pseudonyme ?
Roger Grenier ne put s’en souvenir précisément. La seule chose qu’il pouvait affirmer : le vrai nom d’Aréga, imprononçable, commençait par un Z.
Ce n’était pas par hasard qu’il choisit, pour inverser la donne ou piper les dés, pour ne plus être dans les derniers de toutes listes, la première lettre de l’alphabet en initial pour de ce pseudonyme tout neuf, qu’il empruntait en le déformant à celui du romancier espagnol Pio Baroja qu’il admirait. Baroja devenant par une curieuse distorsion de l’esprit : Aréga.
Il est troublant, à la lecture de Comme si c’était fini (récit des années de guerre traversées par l’écrivain) et du Débarras (roman pratiquement autobiographique), de constater que le Je de la narration n’est à aucun moment nommé. Dans les dialogues les personnages qui s’adressent au narrateur ne prononcent jamais ni son prénom ni son patronyme. Ce Je n’est même pas Aréga puisque l’auteur, sorte de divinité, n’est que le créateur de celui qui narre et non sa représentation.
De même, lorsque le héros du roman de Grenier, La Follia, demande à Bunim (alias Léon Aréga) son prénom, celui-ci lui répond cette phrase terrible : Je n’en ai pas. Je n’en ai plus besoin. Toute ma famille a disparu pendant la guerre, beaucoup de mes amis aussi, et il n’y a plus personne qui soit susceptible de m’appeler par mon prénom.
En biographe à la paresseuse (comme l’aurait dit Henri Calet), je laisse ce Z enfoui dans son passé et tente de trouver une image de Léon Aréga que j’aurais épinglée sans légende… une photo… une caricature… un portrait de peintre ; mais sur ce point également, je ne dénichais aucune trace, aucune piste.
Pour l’imaginer je dispose toutefois de la description du Bunim de La Follia : Il portait des cheveux longs, jaunes avec des mèches plus claires que d’autres, une barbe grise désordonnée qui, avec son gros nez rond, ses fortes pommettes et son front bombé, dont les os saillants, mal raccordés les uns aux autres semblaient soudés de travers, lui faisaient une tête de moujik. (…) Il avait un fort accent (…) Sous la barbe, il avait une pomme d’Adam proéminente, qui tressautait.
On comprend vite à la lecture de cette description que notre monsieur Z n’avait aucun soupçon de la beauté d’un jeune premier.
Mais, ce portrait dans la trame du roman La Follia, était-il à l’image de notre homme ? À cette question Roger Grenier me répondit par la négative. Il n’était pas beau, c’est tout ce que l’on peut dire, me précisa-t-il. En ajoutant une anecdote que j’ai du mal à retranscrire tant les limites de la malveillance humaine peuvent parfois crever le mur du son de l’abject. Tant pis la voici : Un rédacteur de France-Soir (Quotidien pour lequel, nous le verrons, Aréga travailla) est tombé très malade. Ses collègues ont voulu lui offrir un cadeau et lui ont demandé ce qui lui ferait plaisir. Il a répondu « Je voudrais un singe. Je l’appellerai Aréga. » Peut-on espérer qu’aucun de ces collègues attentionnés n’aient émis le moindre rire ou le moindre gloussement, à cette malsaine proposition.
Il n’était donc pas beau. Les regards devaient s’attarder bien peu sur sa physionomie et sans doute avec un léger déplaisir. Ce portrait disgracieux me ramena à un passage lu dans Le Débarras, une phrase une nouvelle fois terrible : Peut-on vivre, œuvrer, sans être un tout petit peu regardé ? Le Paradis c’est les autres, dit un philosophe. Les autres, c’est tout, le reste n’est qu’Enfer… Enfer d’une fille laide affamée de regards.
‘Affamé de regards’ quel cruel constat ! On peut être affamé d’amour, affamé d’affection mais si de prime abord, on est affamé de regards, cela laisse présager que l’affection et l’amour sont bien loin de nous nourrir à leur tour.
Un regard sur nous et l’enfer de ne pas exister s’estompe. Il s’éclipse le temps de ce simple passage des yeux sur notre visage et notre physionomie.
Dans les dernières pages de son récit Comme si c’était fini, le narrateur évadé tente de se faire réformer pour revenir enfin à la vie civile ; le médecin-chef le regarde et se tait, et Aréga, à travers son narrateur, de penser : Que va-t-il me dire ? Je ne sais pas ce qu’il regarde surtout : ma tête ou mon accoutrement. On m’avait un jour giflé dans un commissariat de police et, au moment des excuses, le commissaire me dit : « Que voulez-vous, monsieur, vous avez une tête qui ne nous revient pas ». J’ai peut-être repris cette tête depuis que l’évasion est terminée.
*
Existe-t-il encore une tombe quelque part au cimetière de Thiais ou bien sa concession a-t-elle été reprise par la commune ? Léon Aréga avait, nous l’avons vu, si peu de famille vivante encore que personne n’a dû songer à renouveler cette concession. Roger Grenier qui l’accompagna jusqu’au pied de sa dernier retraite (son dernier Débarras), note dans Le Paradis, c’est les autres ! : Quand cet esseulé est mort, il s’est trouvé une vingtaine d’amis pour l’accompagner au cimetière de Thiais. Il y avait aussi un rabbin. Une dispute a éclaté entre nous, les uns partisans d’un enterrement religieux, les autres soutenant qu’Aréga n’en aurait pas voulu. Je me suis souvenu d’un de ses aphorismes : « Quand un Juif dit qu’il ne croit pas, il ne faut pas le croire. »
Mais même si cette tombe existait encore, à quel nom faudrait-il la chercher pour découvrir enfin les dates figurant sur la dalle, ces dates qui borneraient sa vie ?
Nous savons que Léon Aréga est né en 1908 à Prasnich, ville de la Pologne Russe. Roger Grenier situe celle de son décès dans les années soixante-dix, mais ne parvient pas à se souvenir exactement de ce jour où l’on se disputait pour savoir si on devait opter pour un enterrement religieux ou non.
Au-delà de Dieu et des croyances, quel regard pouvait porter Léon Aréga sur la mort ? Peut-être est-elle à l’image de cette phrase du Débarras, une phrase au ton résigné mais d’une résonnance apaisante : Rencontrer la mort et l’accueillir c’est peut-être savoir embrasser d’un même regard tous les temps, les heures qui furent et celles qui viendront pour d’autres.
Il avouait aussi souvent : Quand j’étais enfant, Dieu m’aidait toujours à pleurer.
L’unique pièce biographique concernant Léon Aréga que put me communiquer Roger Grenier est cette notice remise à Gallimard en 1956. Je la retranscris intégralement :
« Je suis né le premier décembre 1908 en Pologne Russe, dans la ville de Prasnich, - située à quelque trente kilomètres de la frontière de Prusse Orientale, - que nous avons quittée en 1915, durant la bataille de Tanenberg.
Je ne parle aucune langue slave. J’ai terminé mes études secondaires en Belgique où j’ai également suivi des cours de philosophie à l'Université de Bruxelles.
Je suis à Paris depuis 1930 où j’ai étudié le Droit et particulièrement l’Economie Politique. J’ai collaboré, pendant les années 1933-39, à divers travaux de Sciences Économiques, dont un ouvrage sur la "formation de l'épargne" qui fut sur le point de paraître en 1939.
J'ai fait la guerre, en qualité d'engagé volontaire, sur le front de la Somme où je fus fait prisonnier le 6 juin 1940.
Evadé du stalag VII-A (8 octobre 1941, 3ème évasion). À Marseille jusqu’en novembre 1942 (Mouvement Libération Zone Sud). Interné en Espagne (novembre 42-juin 43), j'ai pu rejoindre les F.F.L. à Casablanca, le 1er juillet 1943. (Médaille de la Reconnaissance Française).
Depuis mon retour d’Allemagne (fin 1941) mes occupations sont d’ordre purement littéraire. Je prépare actuellement le récit de mon séjour en Espagne, intitulé "Pour rien", et un essai sur Sénancour dont un des principaux thèmes est déjà amorcé dans ‘L’Arpenteur’ texte à paraître prochainement. »
*
Lorsqu’Albert Camus recommanda Léon Aréga à Roger Grenier, il lui précisa : qu’il ne s’agissait pas seulement de rendre service à quelqu’un qui cherchait du travail, mais qu’[il serait] heureux de connaître cet homme d’une qualité exceptionnelle. Etre considéré par Camus comme un homme de qualité exceptionnelle, cela devait attester de la sympathie et de la confiance qu’il devait porter à Aréga.
Un parrainage aussi prestigieux ne pouvait être qu’un sésame inespéré pour Léon Aréga.
Mais la malchance semble être un des éléments moteurs de son existence (rappelons-nous de son Chacun rate sa vie, à sa manière, selon ses moyens et ses convictions.), et ainsi par malchance également, ce parrain, cet ami, Albert Camus, trouva la mort aux premiers jours de janvier 1960, dans un accident de voiture. Une voiture conduite par Michel Gallimard neveu de Gaston, elle quittera la route et s’en ira percuter un arbre pour s’enrouler dans un second. Le monde des lettres venait de perdre une des plus belles figures de la littérature et de la philosophie ; Léon Aréga pour sa part perdait un ami et un joker qu’il avait discrètement glissé dans sa poche révolver.
Outre l’estime de Camus, nous révèle Roger Grenier, Aréga avait gagné celle de Jacques Lemarchand (dédicataire du Débarras), de Sartre, de Simone de Beauvoir, mais les uns avaient disparu, les autres s’étaient éloignés et, dans le monde des lettres, si dur à qui ne sait pas jouer le jeu, il s’était retrouvé seul, de nouveau. (…) Je crois bien qu’il ne lui restait que moi.
Seule l’écriture l’exalta. Elle était, dans l’enclos de sa solitude, un foyer de passion capable de consumer de ses flammes tous les chagrins, toutes les humiliations, toutes les malchances, tous les ratages qui jalonnèrent sa vie pareils à ces cratères d’obus que l’on voit le long des voies ferrées bombardées. S’affubler sa vie durant d’un accoutrement qui vous a été collé par mille hasards indésirables, cela doit pouvoir faire quelque chose dans l’appareil à penser, dans notre âme… s’interroge Léon Aréga, toujours dans Le Débarras.
Mais l’écriture ne nourrit pas toujours. Les ouvrages de Léon Aréga n’ont pas eu de succès, peut-être par malchance, peut-être aussi à cause du Mektoub... Enfin il ne pouvait espérer en vivre. C’est donc à France-Soir qu’il gagnera son pain quotidien. Dans ce grand journal dirigé à l’époque par Pierre Lazareff, il occupera, non pas un poste de rédacteur, mais celui de documentaliste avec quelques tâches d’archivages en bonus. La femme toute-puissante (une certaine Paula) qui régnait là lui paraissait une incarnation du diable et il croyait voir des étincelles dans ses yeux. Ses misérables collègues se moquaient de lui, nous confie Roger Grenier dans Le Paradis, c’est les autres !
En employé terrorisé par cette terrible Paula aux yeux de braises –de celles qui se consument en enfer– Léon, lorsqu’il apprit sa mutation dans les murs de la rue Sébastien-Bottin (Aujourd’hui, rue Gaston Gallimard), n’osait plus rendre visite à son ami Roger et lorsqu’il se décidait, prenait toutes sortes de précautions, prenait des itinéraires impossibles dans les couloirs, de peur de la rencontrer.
Léon Aréga s’inspirera de cette expérience pour écrire son plus beau roman : Le Débarras. France-Soir y deviendra La France, Pierre Lazaraff : Balthasar Naintaulain et la terrible Paula portera tour à tour les prénoms des femmes qui se succédèrent à son poste : Louise, Georgette, Nicolette, etc.
Le narrateur n’y est pas documentaliste, il occupe l’emploi de Préciseur fonction qu’Aréga invente de toute pièce. Qu’est-ce donc qu’un Préciseur ? Veuillez regarder ce cadre rectangulaire au milieu de la colonne (de La France) : tous les enlèvements d’enfants survenus dans le XVIe arrondissement de Paris depuis le début de notre siècle… c’est le travail des préciseurs… Chaque fois qu’un événement se produit, un événement assez important pour occuper la première page de La France, les préciseurs cherchent et trouvent tous les événements analogues connus dans le passé… Un enfant vient d’être enlevé aux environs de la porte de la Muette : il faut montrer que c’est du déjà vu, que le présent, c’est déjà du passé, que seul demeure inconnu l’avenir, porteur d’espoir, de chance pour tous de merveilles absolument neuves… Nous explique Léon Aréga.
Au septième étage de l’immeuble du journal La France, se trouve le Bureau des Préciseurs. Le narrateur coule avec ses collègues des nuits tranquilles (car c’est de nuit qu’ils accomplissent leur tâche) en recherchant dans les archives des précédents à des assassinats crapuleux, des crimes passionnels, des suicides d’actrices, des règlements de comptes à Montmartre, des morts de clochards-millionnaires, etc. jusqu’au jour où vient les rejoindre dans leur fonction, un certain Étienne Rondoux, prestigieux titreur tombé soudain en disgrâce. Cet évènement leur ouvrira les yeux sur leur pauvre condition humaine, sur leurs mornes existences.
Le Bureau des Préciseurs n’est en fait que la dernière marche de l’édifice de La France, mais une marche bien particulière : elle ne peut mener au-delà, on ne peut de ce point atteindre les marches supérieures ; en revanche ce palier peut recevoir le malheureux qui dégringole des hauteurs. Les limogés. Ce constat amène Sollar, l’un des préciseurs à s’exclamer pour rire : Limoges, Limoges, tous les voyageurs descendent du train… Ici, Limoges, correspondance pour nulle part…
Mais ce que va leur apprendre Étienne, le limogé, sur leur véritable condition va changer le visage qu’ils avaient de leur monde… de leur fonction… Un soir, il leur révélera les confidences que lui avait faites le directeur de La France (Balthasar) à l’époque où il était encore un titreur respecté et admiré : Étienne, que pensez-vous de la gynocratie?... Régime pour hommes seuls... sans ambitions... pour hommes lents... seuls et lents, qui manquent d'impatience... je veux dire : qui ne sont pas impatients d'arriver ... marchent à pied, seuls, lents, pas pressés d'aboutir... une seule maîtresse, pas de voiture, pas de chauffeur... seuls parce que lents... vivent en retard – dans le passé, dans le présent, pas dans l'avenir... Étienne que pensez-vous de la gynocratie? ... Régime naturel pour l'insuccès... gouvernement pour hommes en retard ... Un coin du septième étage, deux fenêtres sur la tour Eiffel, Louise devant un téléphone blanc, donnant des ordres à cinq ou six Retardataires... Louise, chef des Archéologues... ou, comme elle dit, des préciseurs – dénicheurs de précédents... cinq ou six hommes fouillent le passé, miroir du présent, du présent déjà dépassé, déjà en retard...
Il est bon de préciser la devise de Balthasar Naintaulain directeur de La France : « Le présent c’est déjà le passé ».
Cette confidence bouleversera nos dénicheurs de précédents… Le narrateur en arrivant chaque soir devant la porte de ce bureau du septième, ne lit plus ‘Bureau des Préciseurs’, mais Débarras… et sur la petite plaque carrée, suspendue à l’anneau de la clef de ce bureau, il ne lit pas, non plus, le chiffre trois cent quatre-vingt-dix-huit, ses yeux lisent également Débarras.
Ainsi les préciseurs passerons, à compter de cette révélation, le plus clair de leurs nuits (si aucun événement dramatique ne vient troubler le cours de la nuit et ne nécessite de trouver rapidement des précédents) à s’interroger sur eux-mêmes. Ils prendront l’habitude, pour situer les époques du cours de leur existence au Débarras, de dire : « Cela se passa avant l’arrivée de Rondoux », « Ceci s’était produit après l’apparition de Rondoux ».
Lorsque l’un d’eux interroge le narrateur pour savoir quel est le chemin qui conduirait du débarras au salon… [Il se souvient] d’avoir crié : Aucun !
Dans ce vivier, nos Retardataires, nos Archéologues : Sollar, Martial, Bastien, Rondoux et le narrateur, pour les nommer, iront jusqu’à accomplir des actes extrêmes : Sollar aura une bouffée de folie et effectuera un séjour en maison psychiatrique ; Bastien et Rondoux se suicideront.
Martial et le narrateur n’iront pas jusqu’à de tels excès. Peut-être avait-il découvert comme le héros d’Antoine et Julie de Georges Simenon la réponse à une au moins de [leurs] questions, la raison pour laquelle tant de gens ne se suicident pas : un moment vient, si on sait s’y prendre, où ce n’est plus nécessaire.
Le narrateur cependant, à l’instar de Léon Aréga constate que n’ayant jamais rien voulu entièrement, quel train [avait-il] pu manquer.
Installé dans une maison de retraite où il imagine que Bastien et Rondoux auraient pu être à ses côtés, le narrateur raconte l’histoire du Débarras à deux pensionnaires de l’établissement avec lesquels il s’est lié.
La lecture de ce roman donne souvent l’impression de lire la transcription d’un monologue intérieur, interrompu par moments, comme si le narrateur s’éveillait et reprenait le fil de son discours direct.
On y trouve également de longs paragraphes dans lesquels le narrateur tente de ce souvenir de l’événement extérieur qui avait bien pu se dérouler telle ou telle nuit pour mieux se rappeler les événements internes au Débarras. Un décor nécessaire à la mémoire comme Aréga nous l’explique : J’arrive ainsi à croire que la nuit où Emile nous lut, jusqu’à une heure avancée du matin, les bizarreries de Bastien, fut celle de la princesse en fuite. Et maintenant tout me revient, tout réapparaît –ma mémoire (et il en est certainement de même de toutes autres) est ainsi faite qu’elle réclame toujours un décor bien précis et ne se met à parler que sur un fond de tableau digne des circonstances…
Dans ce bureau 398 au septième étage de l’immeuble de La France où se retrouve tous les soirs l’équipe des préciseurs ; dans cet enclos où l’ambiance devient de plus en plus pesante et électrique à la suite des révélations de l’un d’eux sur leur triste sort, chacun essaye de comprendre quel a été l’élément, quel a été l’instant improbable où leur destinée a été irrémédiablement scellée.
Pourquoi cherchent-ils sans raison et sans espoir/à nommer le galet qui les a fait trébucher ? Se questionne Léon Aréga. Peut-être avait-il lui-même cessé de chercher cette faille où la malchance avait infiltré le cours de son existence.
Le récit de Léon Aréga : Comme si c’était fini, est paru en 1946, il relate la traversée de ses années de guerre ; une guerre dans laquelle il s’engagera alors qu’il ne possédait aucune nationalité qui l’obligeait à se ranger sous tel ou tel autre drapeau.
Ainsi incorporé dans la Légion Étrangère, il partira sur le front déjà éventré par les forces allemandes. Prisonnier, il s’évadera par trois fois pour retrouver à la libération son état d’origine celui d’étranger à la nation. J’ai été prisonnier de guerre français ; j’ai été ‘trois fois évadé’. Me revoici étranger. J’ai recouvré, depuis que l’évasion est terminée, mon ancien état-civil.
Dès son engagement il comprend que pour tout le monde c’est seulement la guerre, pour nous ça va être le pogrom.
Son bataillon est stoppé par les Allemands à Villiers-Carbonnel. On divise les prisonniers en trois groupes : les Français, les étrangers (Espagnols, Belges, Suisses, etc.) et les Juifs. Aréga comprend ce qui l’attend : Juif, étranger, volontaire : voici la masse que je sens s'abattre sur ma tête. Je ne suis pas Aryen. Je ne suis pas Français. Je n'ai pas été mobilisé de force. Trois fois hors la loi et prisonnier de guerre en 1940, sous le règne de Hitler. Je n'ai pas été appelé à faire la guerre, je me suis proposé volontairement pour combattre contre les Allemands : ennemi de l'Allemagne. Je ne suis pas Aryen de la race blonde du Nord, je suis Juif : ennemi de l'Allemagne. Je ne suis pas Français, je suis étranger, ennemi de tous, ennemi universel, toujours et partout : donc, ennemi de l'Allemagne. 'Trois fois ennemi de l'Allemagne et prisonnier des Allemands en 1940 ; n'est-ce pas suffisant pour imposer silence à la matière grise ?
Comme si c’était fini si ce n’est pas un voyage au bout de la nuit, est surement un voyage au bout de l’enfer.
*
Si la biographie de Léon Aréga est semée de larges plages ajourées, il nous lègue toutefois la texture aux mailles serrées de son travail d’écriture qui seul le galvanisait.
Les ouvrages de son œuvre sont actuellement difficilement disponibles. Des six volumes que compte sa production, je n’ai pu découvrir que les deux d’entre eux dont je parle rapidement dans ce texte : Le Débarras et Comme si c’était fini. Mais peut-être que le hasard d’une future brocante ou dans les vestiges d’un débarras découvrirai-je l’un ou l’autre de ceux qui me manquent.
En dernière page de son ultime opus, sous la liste des ouvrages déjà publiés par l’auteur, il est indiqué : ‘En préparation’ : Un coq pour Asclépios, roman.
Ce manuscrit a disparu ou bien s’est égaré lors du transfert des effets d’Aréga vers cette obscure destination dans laquelle on relègue les affaires des trépassés sans famille et donc sans héritier : aux oubliettes des débarras.
Ce manuscrit était-il achevé ? A-t-il été soumis au comité de lecture de Gallimard ? A-t-il été refusé ?...
Nous l’ignorons.
Tout comme nous ignorons si son sujet s’inspirait de l’énigme que laissa Socrate avant de mourir en formulant cette ultime supplique adressé à Criton : « Nous devons un coq à Asclépios » ?
Il ne reste de cet ouvrage que son titre et l’annonce prochaine (sic) de sa parution.
Asclépios (ou Esculape) est le dieu de la médecine. Fils du Dieu Apollon et de la mortelle Coronis, il meurt foudroyé par Zeus pour avoir ressuscité les morts, avant d'être placé dans le ciel sous la forme de la constellation du Serpentaire.
Peut-on espérer qu’Asclépios s’il ne pourra jamais ressusciter Léon Aréga en personne, ramène à la vie, sous la forme ne serait-ce que d’une humble réédition, au moins l’un de ses ouvrages.
À la fin de sa vie, retiré à Eze-village, petite commune perchée dans les Alpes-Maritimes, il écrivit à Roger Grenier, un jour de février 1967 : J’ai envie de me cacher, de me réfugier dans quelque moulin abandonné, inconnu du Guide Bleu. Mais ce projet est hors de mes moyens, comme tout autre projet du reste.
David Nahmias (11/2013)

Ouvrages de Léon Aréga :
Comme si c’était fini, récit, Gallimard, 1947
A l’essai, roman, Gallimard, 1951
Le même fleuve, roman, Gallimard, 1954
Pseudonymes, roman, Gallimard,1 957
Aucune trace, roman, Gallimard, 1963
Le Débarras, roman, Gallimard, 1967
|
Notice Biographique de Léon Aréga remise en 1956 à Gallimard « Je suis né le premier décembre 1908 en Pologne Russe, dans la ville de Prasnich, - située à quelque trente kilomètres de la frontière de Prusse Orientale, - que nous avons quittée en 1915, durant la bataille de Tanenberg.
|
Ouvrages et articles consultés pour la rédaction de cet article
La Follia de Roger Grenier, roman, Gallimard, 1980
Fidèle au poste de Roger Grenier, Gallimard, 2001
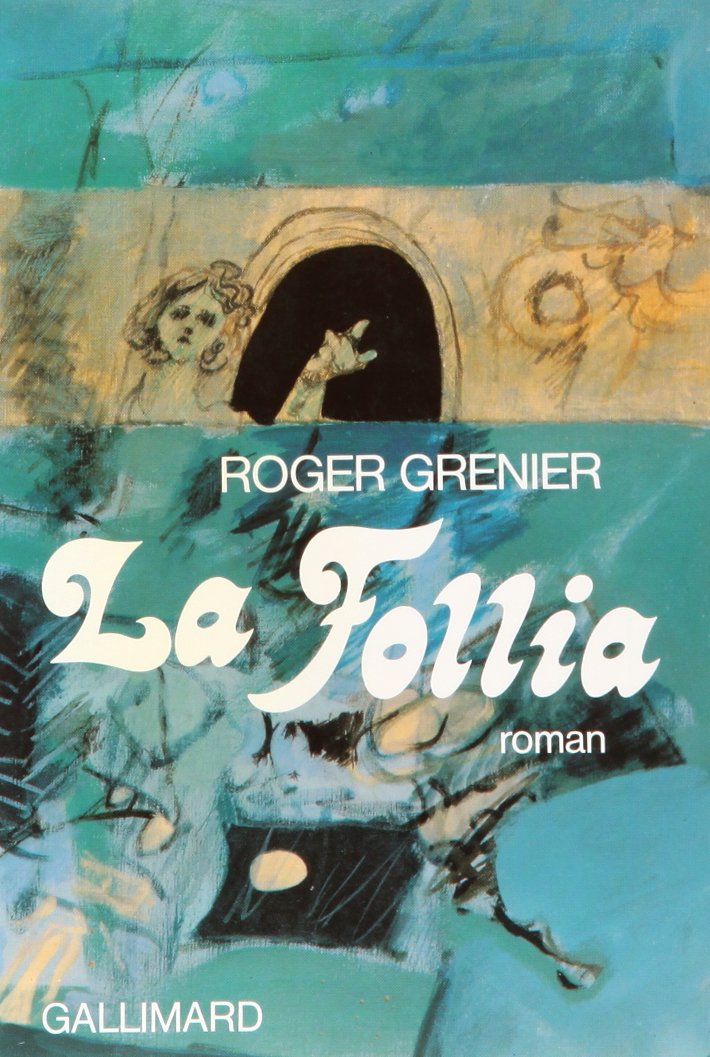
La Quinzaine Littéraire n° 25, avril 1967. Chronique de Maurice Chavardès sur Le Débarras de Léon Aréga : Les naufragés.
Le Matricule des Anges n° 65. Chronique d’Eric Holder : Les enfants des Calet
Liberté, vol. 12, n° 4, 1970, p. 92-105 : Les romanciers juifs français d’aujourd’hui d’André Elbaz.
 Le septième étage du journal France-Soir
Le septième étage du journal France-Soir
Un journal fait par des gens qui ne savent pas écrire pour des gens qui ne savent pas lire.

Incendie du journal France-Soir en 1974
 Je me suis souvenu d’un de ses aphorismes : « Quand un Juif dit qu’il ne croit pas, il ne faut pas le croire. » Roger Grenier
Je me suis souvenu d’un de ses aphorismes : « Quand un Juif dit qu’il ne croit pas, il ne faut pas le croire. » Roger Grenier
 Lecteur absorbé par la lecture du Débarras
Lecteur absorbé par la lecture du Débarras
S’affubler sa vie durant d’un accoutrement qui vous a été collé par mille hasards indésirables, cela doit pouvoir faire quelque chose dans l’appareil à penser, dans notre âme…
 Peut-on vivre, œuvrer, sans être un tout petit peu regardé ? Le Paradis c’est les autres, dit un philosophe. Les autres, c’est tout, le reste n’est qu’Enfer… Enfer d’une fille laide affamée de regards.
Peut-on vivre, œuvrer, sans être un tout petit peu regardé ? Le Paradis c’est les autres, dit un philosophe. Les autres, c’est tout, le reste n’est qu’Enfer… Enfer d’une fille laide affamée de regards.
 s Trompettes Marines
s Trompettes Marines 